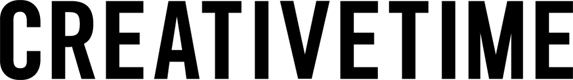A Haitian sugar cane worker cutting cane in a field in San Pedro, Dominican Republic. March 1, 2012. Photo by Spencer Platt/Getty Images.
Pour lire cet article dans sa version originale française, cliquez ici.
—
The long black tunnel extends, without a day’s break, from March to September. A seasonal route to divert the pain that got into the habit of striking down on us like the machete’s blade. It’s a world of scents of rotten twigs, of soil. I made my abode there among minuscule critters, insects or larvae, whether they liked it or not. It’s dark at all times and I’m not afraid. Mine is this tomb, which cultivates and protects the silence so necessary for resting. I’m a fine connoisseur of the darkness that life has taught me to pass through with my heart. The dark neutralizes the power of the eyes and brings the body back to its critical degree of uselessness.
A cane laborer needs a hiding place. You have to outsmart this produce that grows while slicing through your skin with each wind gust. The furrows I wear on my body are like ramps onto the road of the sugar of sweetness and the rum of intoxication leading toward New York, London, Milan. Over there, on the other bank, where apparently other vigorous hands run the machines, carry the crates, shake the blenders until exhaustion. The mills, the bars, the distribution channels are just like so many cane fields. Bitter.
The tunnel opens up over there, onto the river, at the site where it is fullest, from the vigor of water bringing wild foam down from the hills up above. This is the very place where you should drink up, before the canal that diverts the water toward the plain. The sugar cane is voracious. It’s always thirsty. It must have water, water and the sweat of us workers. After the cane fields, all that’s left is a miserable little trickle. The cane drinks what it can and doesn’t mind drying up the simplest and most legitimate hopes.
To get out of the tunnel, I quite enjoy my dead-man approach. I’ll come back tomorrow during break. At the same time and with the same need to rest my old bones. I can’t dawdle. I know inside out the excesses of the supervisor who’s paid too much to check off the names at roll call so work can resume. Twenty years we’ve known each other. The company hired us the same day. He rose up the ranks because he’s learned. He knows how to read names and sign attendance sheets. Me, I was born with a machete in my hand. I’ve only ever had the gift and the experience of cutting cane, sleeping grass snakes and foul winds. All the Christian saints or whatever be my witness, I’m sure I could cut the alchemical pipes that manage to make my sweat into small candies, small cakes and small glasses. Perhaps the supervisor and his bosses can’t imagine that.
Although…every night I fall asleep on the certainty of a fortnight’s pay. We can’t do without it and the family is like the cane. It’s voracious. The youngest daughter must go to a school for small children who don’t know how to defend themselves or pee without help yet. She hasn’t reached an age where she can understand. Yes, times have changed! Too fast. Too expensive. Now girls are going to school before they’ve learned to hold it in. The state says nothing. Pays nothing.
Except…at the agricultural fair, on the first of May, a big boss—more powerful, better dressed and better educated than the supervisor, talked to us before he ordered that we be served aged rum, the greatest happiness the cane can provide. Here, as at the other end of the chain, over there in New York, London and Milan.
Let’s raise our glasses to a great crop for the Haitian Sugar Cane Company and to all the refineries in the world. Believe me, you are heroes. Your labor feeds the happiness of others. The world needs sweetness and evanescence. To your work, which makes the world sweeter!
It’s so much better than going to war.
Translated by Christine Schwartz Hartley
—
Boire mon doux corps
Le long tunnel noir, c’est chaque jour de mars à septembre. Une voie de saison pour dérouter la douleur qui a pris l’habitude de s’abattre sur nous comme la lame de la machette. C’est un monde de parfums de brindilles pourries, d’humus. J’y ai fait ma demeure au milieu des petites bêtes minuscules, insectes ou larves à leurs corps défendant. Il fait noir à tout heure et je n’ai pas peur du monde. Le mien est ce tombeau qui cultive et protège ce silence tellement nécessaire au repos. Je suis fin connaisseur du noir que la vie m’a appris à traverser avec le cœur. L’obscurité neutralise le pouvoir des yeux et ramène le corps à son degré critique de l’inutilité.
Un travailleur de la canne a besoin de cachette. Il faut ruser avec ce produit qui grandit en vous tranchant la peau à chaque coup de vent. Je porte, sur mon corps, des sillons qui sont autant de raccords à la route du sucre de la douceur et du rhum de l’enivrement vers New-York, Londres, Milan. Là-bas, à l’autre bord de l’eau où, paraît-il, d’autres mains vigoureuses font tourner les machines, portent les caisses, secouent de mélangeurs jusqu’à épuisement. Les usines, les bars, les chaines de distribution sont autant de champ de cannes. Amères.
Le tunnel s’ouvre là-bas sur la rivière et à l’endroit où elle a le plus de membre, de la vigueur d’une eau qui porte l’écume sauvage des mornes d’en haut. Il faut se ressourcer à ce point précis, avant le canal qui détourne l’eau vers la plaine. La canne à sucre est vorace. Elle a toujours soif. Il lui faut de l’eau, de l’eau et de la sueur de nous autres travailleurs. Après les champs de canne, il ne reste qu’un petit filet misérable. La canne boit ce qu’elle peut et ne se gêne pas d’assécher les plus simples et les plus légitimes espoirs.
Pour sortir du tunnel, je me plais dans ma démarche de trépassé. Je reviendrai demain à la pause. A la même heure et avec le même besoin de reposer mes vieux os. Je ne peux pas traîner. Je connais par cœur les excès du superviseur trop payé pour cocher les noms à l’appel pour la reprise du labeur. Vingt ans qu’on se connaît. La compagnie nous a embauché le même jour. Il est monté en importance parce qu’il est savant. Il sait lire les noms et signer les rapports de présence. Moi, je suis né avec une machette dans la main. Je n’ai toujours eu que le don et l’expérience de couper la canne, les couleuvres endormies et les mauvais airs. Par tous les saints chrétiens ou je ne sais pas, je suis sûr de pourvoir couper les tubes de l’alchimie qui arrivent à transformer ma sueur et petits bonbons, petits verres et petits gâteaux. Peut-être que le superviseur et ses patrons ne s’en doutent pas.
Quoique… je m’endors chaque soir sur la certitude de la paie de la quinzaine. On ne peut pas s’en priver et la famille c’est comme la canne. Elle est vorace. La petite dernière doit aller à l’école des petits qui ne savent pas encore se défendre et faire pipi sans aide. Elle n’a pas encore l’âge de comprendre. Oui, les temps ont changé ! Trop vite. Trop cher. Les filles vont désormais à l’école avant d’apprendre à se retenir. L’État ne dit rien. Ne paie pas.
Sauf… à la fête de l’agriculture, le premier mai, un grand chef plus puissant, mieux habillé et plus instruit que le superviseur nous a parlé avant d’ordonner qu’on nous serve du vieux rhum, le plus grand bonheur que puisse procurer la canne. Ici comme à l’autre bout de la chaine, là-bas, à New-York, Londres et Milan.
Levons nos verres à la grande moisson de la Compagnie Haïtienne de la Canne à sucre et à toutes les raffineries du monde entier. Croyez-moi, vous êtes des héros. Votre labeur alimente le bonheur des autres. Le monde a besoin de douceur et d’évanescence. A votre travail qui adoucit le monde !
C’est tellement mieux que de partir en guerre.
—
Read more pieces related to the themes Kara Walker explores in A Subtlety: Edwidge Danticat: “The Price of Sugar,” Tracy K. Smith: “Photo of Sugar Cane Workers, Jamaica, 1891,” Ricardo Cortés: “The Act of Whitening” and Shailja Patel: “Unpour.”